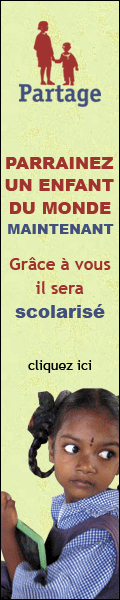Le centenaire de la Première Guerre mondiale a engendré de très nombreuses publications - romans, documents, récits, anthologies – et parmi eux, je me suis laissé tenter par le dernier texte de Jean Rouaud, Eclats de 14 (aux éditions Dialogue). Sans doute une commande, ce livre n’en est pas moins un bel objet poétique. Commençons par la forme : il s’agit d’un petit format, 16 x 16 cm, de 96 pages, illustré par les dessins du peintre breton, Mathurin Méheut.
Le centenaire de la Première Guerre mondiale a engendré de très nombreuses publications - romans, documents, récits, anthologies – et parmi eux, je me suis laissé tenter par le dernier texte de Jean Rouaud, Eclats de 14 (aux éditions Dialogue). Sans doute une commande, ce livre n’en est pas moins un bel objet poétique. Commençons par la forme : il s’agit d’un petit format, 16 x 16 cm, de 96 pages, illustré par les dessins du peintre breton, Mathurin Méheut.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Méheut est un artiste qui lors de la Première Guerre mondiale a participé aux combats tout en dessinant ce qui se déroulait sous ses yeux. Au total quatorze dessins et aquarelles illustrent les textes de Jean Rouaud. A la fin de l’ouvrage, on découvre non seulement la biographie de Méheut mais surtout le titre de chacune de ses œuvres ainsi que la technique appliquée.
L’apport de ces illustrations est pertinent car il permet de recréer l’ambiance de cette guerre et d’accompagner les textes de Jean Rouaud qui évoquent ce conflit sous les quatre éléments de l’univers : la terre, le feu, l’eau et l’air. Le livre s’ouvre sur une critique féroce de cette guerre : non les combattants n’ont pas aimé se battre, sacrifier leur jeunesse ni mourir pour la patrie. Après la guerre, les hommes ont pris conscience de ce grand gâchis, cette fausse « guerre haïku » qui au lieu de n’être qu’une « guerre éclair » fut une véritable boucherie entrainant des milliers de morts. Et pourtant, rappelle Jean Rouaud, chaque 11 Novembre, nous commémorons l’Armistice, c’est bien que cette guerre a encore une résonnance au fond de nous, Français. Selon lui, c’est parce qu’elle est le « dernier conflit classique, deux armées s’affrontant sur le terrain », « la dernière « victoire » d’une armée française. Elle ponctue la fin de ce qu’a été la France ». Puis Jean Rouaud de rappeler les fantasmes de cette guerre qui devait être qu’un éclair : les hommes partant au combat à travers champs, par un mois d’août ensoleillé. Mais ces champs furent labourés par les tranchées, troués par les obus. Il ne resta rien de cet instant plein d’espoir patriotique.
L’auteur des Champs d’honneur montre comment, peu à peu, les différents éléments (le feu, la terre, l’eau et même l’air) se sont invités dans cette guerre au travers des coups de canons, des tranchées, des inondations et des avions mitrailleurs.
Suite à ce magnifique texte poétique qui dit avec grâce et rage les horreurs de ce carnage, on découvre une préface que Jean Rouaud a consacré pour une édition d’un choix de poèmes de guerre d’Apollinaire : « L’éclat poétique ». L’auteur rend hommage au poète qui avait prédit que cette guerre serait bien plus longue que ce que l’on avait annoncé. Pourquoi une telle conviction alors que Lou affirme, comme les autres, le contraire ? Pourquoi s’engager quand même dans cette guerre qu’il sait si terrible ? C’est parce qu’il veut devenir français et « qu’il cherche à défendre le pays qui lui a fourni l’arme terrible de la langue pour déployer son verbe ». Guerre et poésie sont étroitement liées : c’est en lisant, dans les tranchées que le poète a vu son crâne voler en éclat et cet éclat lui a inspiré ses poèmes de guerre, dont ces vers cités par Jean Rouaud :
« C’est pourquoi le Rire aux éclats
Est une idée exquise et crâne
Et naguère aux temps des lilas
L’éclat tempêta sous mon crâne. »












 V
V E
E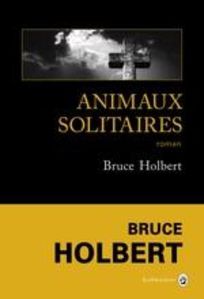 A
A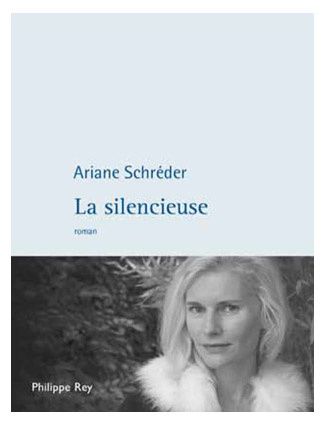 C
C S
S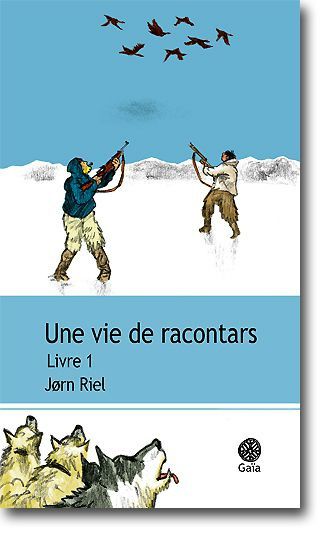 I
I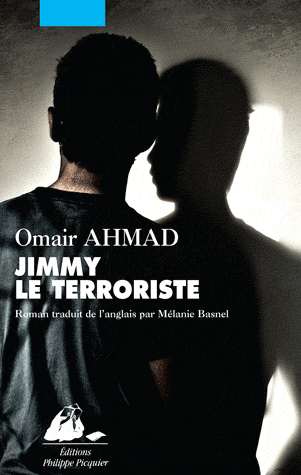 J
J J
J