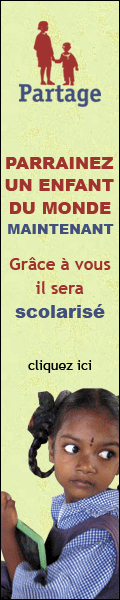Quand on parle d’Hervé Bazin, on pense immédiatement à Vipère au poing, son roman le plus populaire, adapté à la télévision (en 1971) et au cinéma (en 2004). Qui n’a pas lu, au cours de sa scolarité, ce roman autofictif ? Mais Hervé Bazin ne peut se résumer à un seul livre. C’est la raison pour laquelle, je vous propose d’ouvrir un dossier sur cet auteur mal connu, et dont on fête, cette année, les cent ans de sa naissance. Fin novembre, je suis invitée aux Rosiers, près d’Angers, pour animer des rencontres autour de Bazin. Mais patience, je vous informerai peu à peu de l’organisation de ces journées. En attendant, découvrons un peu mieux l’œuvre de Bazin.
Quand on parle d’Hervé Bazin, on pense immédiatement à Vipère au poing, son roman le plus populaire, adapté à la télévision (en 1971) et au cinéma (en 2004). Qui n’a pas lu, au cours de sa scolarité, ce roman autofictif ? Mais Hervé Bazin ne peut se résumer à un seul livre. C’est la raison pour laquelle, je vous propose d’ouvrir un dossier sur cet auteur mal connu, et dont on fête, cette année, les cent ans de sa naissance. Fin novembre, je suis invitée aux Rosiers, près d’Angers, pour animer des rencontres autour de Bazin. Mais patience, je vous informerai peu à peu de l’organisation de ces journées. En attendant, découvrons un peu mieux l’œuvre de Bazin.
Vipère au poing, donc, est le premier roman d’Hervé Bazin. Publié en 1948, il est le premier volet d'une trilogie racontant l'enfance de Jean Rezeau (Vipère au poing), sa jeunesse (La Mort du petit cheval) et sa vie d’adulte (Le Cri de la Chouette). Derrière Jean Rezeau se cache Hervé Bazin.
J’avais lu, à 13 ans, ce roman. De cette lecture, je garde le souvenir très net d’un malaise, d’un dégoût à l’égard de la mère, Folcoche, qui exige de ses enfants qu’ils gardent plusieurs jours les mêmes sous-vêtements et chaussettes, qu’ils exécutent des tâches humiliantes et qu’ils avalent sans broncher l’huile de foie en guise de purge.
Vingt ans plus tard, je relis ce roman avec ce même sentiment de malaise, excepté qu’à l’époque je n’avais pas été aussi sensible à l’humour noir du narrateur. Car en effet, celui-ci ne manque pas de se moquer de son entourage : de sa mère acariâtre et méchante ; de son père, falot et lâche ; de son cadet, cafteur ; et de son aîné, victime. Toutefois, je retrouve dans ce roman l’agressivité, la révolte d’un enfant qui ne supporte pas les brimades et les humiliations de sa mère qui n’éprouve aucun sentiment filial à l’égard de ses fils.
Jean Rezeau est un enfant révolté, qui refuse l’éducation rigide et conventionnelle donnée par sa mère qu’il surnomme alors Folcoche (contraction de « folle » et « cochonne »). La révolte se décèle dès le titre : vipère au poing. En ouverture du roman, Jean étrangle une vipère, et la tient fièrement au poing. Ce geste brutal, criminel, annonce la suite des événements : la mort désirée de Folcoche, le rejet des conventions et du milieu bourgeois et religieux. Et cette image de la vipère, tenue au poing, se retrouve à la fin du roman : « Cette vipère, ma vipère, dûment étranglée, mais partout renaissante, je la brandis encore et je la brandirai toujours, quelque soit le nom qu’il te plaise de lui donner : haine, politique du pire, désespoir ou goût du malheur ! Cette vipère, ta vipère, je la brandis, je la secoue, je m’avance dans la vie avec ce trophée, effarouchant mon public, faisant le vide autour de moi. Merci, ma mère ! Je suis celui qui marche, une vipère au poing. »
L’histoire ensuite, vous devez la connaître : Madame Rézeau et son mari rentrent de Chine quand la grand-mère vient à décéder. Jean et son frère Ferdinand découvrent leur mère qui au lieu de les accueillir à bras ouverts, leur colle une gifle pour les maintenir à distance et leur montrer à qui ils ont affaire. A cette occasion encore, ils rencontrent leur petit frère, Marcel, né en Chine. Très vite, les relations sont exécrables entre la mère et les enfants. Par économie, alors que Madame Rézeau est fortunée, ils ne mangeront à leur faim, seront mal fagotés et surtout n’auront pas le droit d’aller à l’école, un curé leur dispensera les cours. Or, au-delà de cette révolte des enfants, un des thèmes forts, me semble-t-il, de ce roman est l’enfermement. Tout se passe à la « Belle Angerie », domaine familial, sous la surveillance de Folcoche et du précepteur. Les enfants ne peuvent circuler dehors comme ils le souhaitent. La mère a réduit les espaces de liberté au maximum. Par deux fois, grâce à la mauvaise santé de Folcoche, les enfants échappent au joug maternel. Le père, lâche mais plein de bonté, les laissent profiter de ces quelques jours de liberté. Ils ne grattent plus la terre du jardin (corvée quotidienne), font pousser leurs cheveux tondus par Folcoche elle-même, mangent à leur faim et en profitent pour cacher de la nourriture. Mais cette liberté est de courte durée. Dès son retour Madame Rouzeau sépare les enfants. Jean est envoyé avec son frère aîné dans le Gers où ils dorment et mangent comme des princes. Pourtant cette totale liberté dans un climat serein lasse Jean qui éprouve un sentiment de manque à l’égard de sa mère… Mais encore une fois, le séjour prend fin et les deux frères retrouvent la Belle Angerie et ses conventions. Brasse Bouillon (Jean) continue d’alimenter une haine sans bornes pour sa mère qui le lui rend bien. C’est sur ce sentiment de haine et de fureur que se clôt ce roman.
Hervé Bazin a écrit une autofiction, dans laquelle il dénonce les conventions haïssables du milieu bourgeois angevin et passéiste, milieu que l’on retrouve dans bien d’autres régions, en France, à cette époque. Nombreux sont les lecteurs qui se reconnaissent dans les mésaventures de Brasse Bouillon et de ses frères : preuve en est le succès éditorial qui perdure aujourd'hui encore. Ce roman est également très souvent étudié au collège, et pour cause : la prose y est fluide, le vocabulaire simple et ne présente pas de difficultés. Evidemment, malgré l’apparente facilité de lecture, Vipère au poing n’est pas un divertissement. Il agresse, dérange, titille nos certitudes. Mais n’est-ce pas le rôle de la littérature que de bousculer le lecteur ?
 Comme certains le savent, avec les années, j’aime les livres objets. Les éditions Atelier in8 proposent régulièrement de beaux coffrets de nouvelles signées par des auteurs qui méritent toujours que l’on s’y attarde. Des trains à travers la plaine est le titre du dernier coffret paru. Je suis certaine que la chanson de Bashung vous revient aussitôt en mémoire. Et précisément, pour composer ce coffret, quatre auteurs – Marie Cosnay, Jérôme Lafargue, Claude Chambard et Eric Pessan – ont eu à écrire une nouvelle autour de l’univers d’Alain Bashung.
Comme certains le savent, avec les années, j’aime les livres objets. Les éditions Atelier in8 proposent régulièrement de beaux coffrets de nouvelles signées par des auteurs qui méritent toujours que l’on s’y attarde. Des trains à travers la plaine est le titre du dernier coffret paru. Je suis certaine que la chanson de Bashung vous revient aussitôt en mémoire. Et précisément, pour composer ce coffret, quatre auteurs – Marie Cosnay, Jérôme Lafargue, Claude Chambard et Eric Pessan – ont eu à écrire une nouvelle autour de l’univers d’Alain Bashung. 










 Q
Q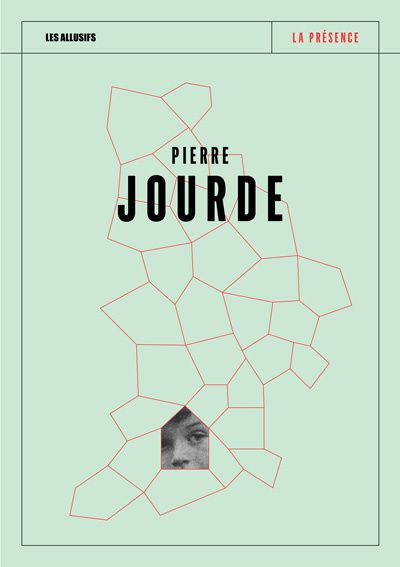 L
L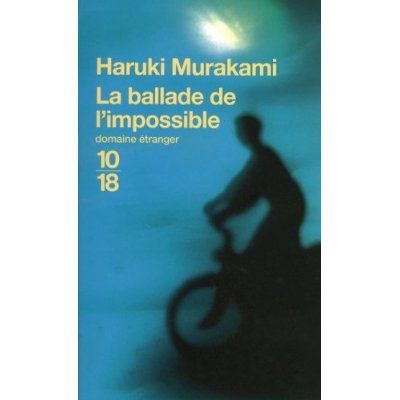 H
H Il y a quelques jours,
Il y a quelques jours,  C
C Il est temps de revenir vers la littérature, avec un écrivain, trop peu connu, hélas, Jacques Abeille. J’ai découvert cet auteur il y a près de quatre ans, grâce à la revue
Il est temps de revenir vers la littérature, avec un écrivain, trop peu connu, hélas, Jacques Abeille. J’ai découvert cet auteur il y a près de quatre ans, grâce à la revue 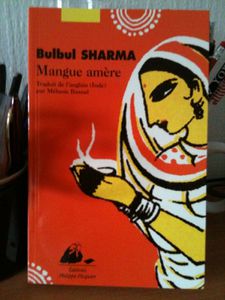 Q
Q A
A P
P Alors que Les Insoumises était un roman épistolaire, Intermittences prend la forme du journal intime, ce qui permet à l’auteur de partager les pensées de ce peintre qui perd pied. Pourtant, ce livre n’est pas qu’un roman sur le statut d’intermittent du spectacle. Il décrit l’univers du travail, celui des précaires et de tous ceux qui acceptent de s’écraser parce qu’ils s’estiment suffisamment gâtés. Ainsi, le narrateur estime que « nous, Français, sommes privilégiés, nous bénéficions de soins médicaux gratuits, l’enseignement est de qualité, les indemnités chômage assurent aux plus démunis de quoi subsister et l’intermittence du spectacle permet aux artistes de créer librement. Bien sûr, il faut savoir être obéissant et ne pas chercher à être plus malin que le système, mais n’est-ce pas un juste tribut à payer ? » Quand on lit la suite du roman, on comprend que non, ce n’est pas un juste tribut et que ce pauvre figurant est bien une victime du système qui n’épargne personne. Ceux qui refusent le traitement des intermittents, dégagent purement et simplement. Ainsi, le narrateur se plaint-il d’avoir fait la même journée 12 heures supplémentaires et « cela ne comptera malheureusement pas comme un cachet de plus. Il faisait un froid de canard dans les studios, on a dû tourner dehors sous la pluie. J’ai encore les mains glacées et je suis au lit avec une bouillotte. Ils nous ont à peine nourris, un bouillon clair, un morceau de pain et un fuit, pris à la va-vite sous une tente qui laissait filtrer le vent et la pluie. […] Une partie de la figuration est partie, opposant qu’il était trop tard et que c’était illégal. J’ai préféré rester, pour me faire bien voir de la chargée de figuration ». Quoi qu’il en soit, les révoltés comme les soumis demeurent dans une précarité évidente, embourbés dans les absurdités administratives. Ce roman évoque bien plus que la situation des intermittents, il décrit la société de tous les laissés pour compte, les vacataires, les demandeurs d’emploi, tous les précaires dont les critères ne correspondent jamais à ceux exigés pour obtenir un boulot, un logement… Intermittences est un roman fantastique, absurde et poétique à la fois. La simplicité de la langue reflète la crudité des situations évoquées. L’omniprésence de la figure de la Folle participe de cette ambiance particulière, à la fois onirique et masochiste. Un très bon roman, engagé et passionnant.
Alors que Les Insoumises était un roman épistolaire, Intermittences prend la forme du journal intime, ce qui permet à l’auteur de partager les pensées de ce peintre qui perd pied. Pourtant, ce livre n’est pas qu’un roman sur le statut d’intermittent du spectacle. Il décrit l’univers du travail, celui des précaires et de tous ceux qui acceptent de s’écraser parce qu’ils s’estiment suffisamment gâtés. Ainsi, le narrateur estime que « nous, Français, sommes privilégiés, nous bénéficions de soins médicaux gratuits, l’enseignement est de qualité, les indemnités chômage assurent aux plus démunis de quoi subsister et l’intermittence du spectacle permet aux artistes de créer librement. Bien sûr, il faut savoir être obéissant et ne pas chercher à être plus malin que le système, mais n’est-ce pas un juste tribut à payer ? » Quand on lit la suite du roman, on comprend que non, ce n’est pas un juste tribut et que ce pauvre figurant est bien une victime du système qui n’épargne personne. Ceux qui refusent le traitement des intermittents, dégagent purement et simplement. Ainsi, le narrateur se plaint-il d’avoir fait la même journée 12 heures supplémentaires et « cela ne comptera malheureusement pas comme un cachet de plus. Il faisait un froid de canard dans les studios, on a dû tourner dehors sous la pluie. J’ai encore les mains glacées et je suis au lit avec une bouillotte. Ils nous ont à peine nourris, un bouillon clair, un morceau de pain et un fuit, pris à la va-vite sous une tente qui laissait filtrer le vent et la pluie. […] Une partie de la figuration est partie, opposant qu’il était trop tard et que c’était illégal. J’ai préféré rester, pour me faire bien voir de la chargée de figuration ». Quoi qu’il en soit, les révoltés comme les soumis demeurent dans une précarité évidente, embourbés dans les absurdités administratives. Ce roman évoque bien plus que la situation des intermittents, il décrit la société de tous les laissés pour compte, les vacataires, les demandeurs d’emploi, tous les précaires dont les critères ne correspondent jamais à ceux exigés pour obtenir un boulot, un logement… Intermittences est un roman fantastique, absurde et poétique à la fois. La simplicité de la langue reflète la crudité des situations évoquées. L’omniprésence de la figure de la Folle participe de cette ambiance particulière, à la fois onirique et masochiste. Un très bon roman, engagé et passionnant.