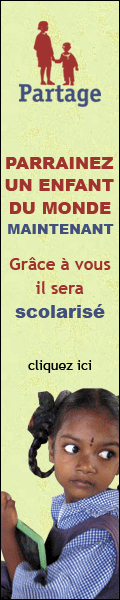Vendredi après-midi, je me suis rendue de nouveau à l’Hôtel Lenox, rencontrer l’américaine Amy Bloom. L’auteur de Ailleurs, plus loin a l’habitude de répondre à des interviews : elle est détendue, confortablement installée sur une banquette en velours. Malgré les rendez-vous qui s’enchaînent, Amy Bloom reste souriante, souvent rieuse.
Vendredi après-midi, je me suis rendue de nouveau à l’Hôtel Lenox, rencontrer l’américaine Amy Bloom. L’auteur de Ailleurs, plus loin a l’habitude de répondre à des interviews : elle est détendue, confortablement installée sur une banquette en velours. Malgré les rendez-vous qui s’enchaînent, Amy Bloom reste souriante, souvent rieuse.
J’ai croisé de nouveau l’auteur au festival America mais elle a dû repartir aux Etats-Unis de façon prématurée et n’a donc pu participer à tous les débats et rencontres comme prévu.
Ailleurs, plus loin est une pure fiction. Le personnage de Lilian ne ressemble en rien à l’un des membres de votre famille qui a connu également l’exil. Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter le parcours de cette femme extraordinaire ?
Dans ma famille, on ne parlait pas du passé, et à cause de ce silence, j’ai eu envie d’en savoir plus. Les personnages viennent de votre inconscient : ce sont des histoires de votre famille, des sensations que vous avez eues en marchant dans la rue… Je pense que lorsque l’on écrit, tout ce que l’on vit, d’une certaine manière, devient du matériau pour façonner des personnages.
En quoi l’histoire de vos grands-parents, juifs d’origine russes, vous a influencé pour écrire cette histoire ?
C’étaient des gens qui aimaient voyager. Mais mes parents étaient très ennuyeux. Il y a des éléments de certains personnages qui font écho à ma famille, de choses que j’ai pu entendre ou dont je me souviens mais mes grands-parents ne parlaient jamais de leur histoire, du passé et quand je les ai connus, ils étaient déjà âgés et ne parlaient pas très bien anglais.
Les histoires qui n’ont pas été racontées sont bien plus fascinantes que les histoires connues. Ce qui m’intéresse aussi c’est le décalage entre ce que les gens racontent de leur histoire et les fictions. D’ailleurs, vous allez peut-être être déçue mais je n’avais pas une curiosité brûlante à l’égard de l’histoire de mes grands-parents. C’étaient des gens pauvres, malheureux, vivant dans un village boueux et qui n’étaient pas contents de vivre aux Etats-Unis.
C’est exactement l’inverse que vous racontez dans Ailleurs, plus loin : Lilian est très forte et parvient à s’adapter à toutes les situations même les plus triviales.
C’est pour cela que je l’ai inventée : elle est beaucoup plus intéressante que mes grands-parents ! [rires]. Pour moi, Lilian n’a rien d’extraordinaire : imaginez que demain vous quittez votre pays pour un autre dont vous ne comprenez pas la langue, vous n’avez pas d’amis, pas d’argent, pas de protecteurs, à quel point la vie que vous y mèneriez serait-elle différente de celle de Lilian ?
Votre roman s’apparente à celui du 19ème siècle, vos personnages ressemblent à ceux de Dickens, parvenant à se sortir de situations dramatiques et à surmonter les obstacles de la vie… Comme le faisaient les romanciers de l’époque, vous suivez vos personnages jusqu’à la fin, du moins vos personnages les plus importants.
On connaît la fin de la plupart de mes personnages. Pas tous : on ne sait pas ce qui arrivent à ses trois enfants qu’elle abandonne. J’aime les romans du 19ème siècle, j’aime la manière dont ils s’achèvent, leurs épilogues mais en même temps j’avais envie de tisser le futur au centre du livre. L’intérêt d’être une romancière du 21ème siècle c’est d’avoir une capacité de mouvement dans la chronologie, dans le temps, d’aller vers le futur et de revenir vers le présent du roman.
Vous êtes un personnage omniscient et vous manifestez votre connaissance supérieure dans les nombreuses parenthèses où vous leur en faites dire plus que ce qu’ils expriment ouvertement.
Le narrateur omniscient a la capacité de voir tout ce qui se passe y compris à différentes époques : connaît le passé, le présent et l’avenir de ses personnages. Aujourd’hui, au 21ème siècle, on aime les livres bavards, les histoires d’introspection, les analyses psychologiques… Dans mes nouvelles, il m’arrive d’utiliser le « je » mais aimant les personnages, j’ai recours à l’omniscience du narrateur qui me permet de raconter leur futur et leur passé.
Vous avez fait des recherches dans des bibliothèques en Alaska sur l’exil, ce personnage de Lilian, etc. Mais comment avez-vous procédé pour écrire cette histoire ?
J’ai mis très longtemps à écrire ce roman mais je ne pourrais dire en combien de temps précisément car j’ai dû m’interrompre deux fois : d’abord pour terminer un recueil de nouvelles [Mauvais genre, avec une nouvelle couverture, tient-elle à préciser] puis pour l’écriture d’un show à la télévision.
En ce qui concerne la méthode, ce n’est pas très intéressant pour vous... parce que je n’en ai pas vraiment. Je m’assois le matin dans mon bureau, je fixe le plafond en me demandant si je vais avancer une scène ou l’intrigue…
Tout le travail de recherches est très amusant si vous aimez lire et vous savez prendre des notes. C’est un faux exercice d’écriture puisqu’il n’y a aucune difficulté. Quand vous le faites, personne ne vous embête parce que vous avez l’air sérieux. Je ne comprends pas que l’on puisse parler du travail de documentation comme quelque chose de difficile puisqu’on lit des histoires qui nous intéressent. Où est la difficulté ? En revanche, l’écriture, c’est difficile.
Vous avez d’abord collecté toute cette documentation avant d’établir un plan ou bien celle-ci est-elle venue en complément de votre histoire ?
Je commence toujours avec une idée de l’histoire et puis il y a un certain nombre de choses que je ne sais pas. Par exemple la durée nécessaire du voyage en train à cette époque, à quel point Seattle était une ville accueillante où les immigrés étaient intégrés… Les choses que j’ignore je les note afin de faire une recherche dessus et après avoir fait les recherches, j’écris. Mais je n’avais pas du tout envie d’écrire un roman où au beau milieu, il va y avoir un traité sur l’histoire de l’immigration ou autres. Mon but n’est pas de montrer à quel point je suis cultivée et instruite à mes lecteurs.
Vous décrivez une Amérique du début du 20ème siècle sans pour autant insister sur l’Histoire de cette époque. Elle n’est finalement qu’une toile de fond…
En effet, le passé n’est pas si différent que cela…Pour moi, le cœur de l’histoire c’est les gens, ce qu’ils vivent et ce qu’ils éprouvent. Je n’avais pas envie d’écrire un roman historique. Pour moi, l’Amérique des années 1920 ressemble à la nôtre. Tout ce qui manque c’est la télé et les ordinateurs car à cette époque tout allait très vite aussi.
Vous décrivez l’univers de Lilian avec une certaine crudité, lui faisant subir prostitution, viol, enfermement…
Lilian pour survivre est obligée de se soumettre, mais elle analyse la situation de façon lucide. Elle sait bien qu’elle est prisonnière du jeu entre Mayer et son père Ruben. Mais elle ne maquille pas la réalité, et donc moi non plus du coup !
Malgré ces situations dramatiques, votre personnage a beaucoup d’humour…
Pour moi, c’est quelque chose d’essentiel chez un écrivain. Une grande partie de mon humour repose sur des jeux de mots. Quand je raconte cette scène d’abus sexuel où l’homme devient impuissant, ça me fait beaucoup rire. Mais je ne raconte pas ça à la manière de Henry Miller ou de Norman Mailer parce qu’eux, je crois que ça ne leur aurait pas du tout fait rire. En revanche, je suis bien consciente que certaines choses peuvent faire rire, d’autres moins. Lilian est capable de rire à ce qui lui arrive, même dans des situations délicates. Je pense à une scène du livre où elle est très embarrassée parce qu’elle a des poux et ce qui la fait rire c’est cette gêne alors que l’homme avec qui elle se trouve est extrêmement sale et qu’il a une chemise pleine de taches de sang et de nourriture.
Pour conclure, j’aimerais savoir si vous aviez de nouveaux projets d’écriture.
Je travaille sur un recueil de nouvelles qui s’appelle : I love to see you coming I hate to see you go [éclats de rire avec la traductrice en raison du jeu de mots avec « Comin’ »/ « coming »], et je commence un nouveau roman…

 Au festival America, il fut aussi question de l’Amérique du Sud qui connaît guérillas, révolutions et dictatures. En temps de guerre, il est difficile de pouvoir s’exprimer librement et de publier ses textes. Horacio Castellanos Moya a payé cher sa liberté de parole. En 1977, il publie dans son pays, Le Salvador, Le Dégoût. Ce texte suscite une telle fureur de la part des Salvadoriens que la mère de l’auteur est menacée de mort. Pour échapper à la guerre civile, Horacio Castellanos Moya décide de s’exiler dans l’espoir de travailler dans de bonnes conditions et continuer d’écrire ce qu’il veut. Aujourd’hui, il vit aux Etats-Unis dans un programme d’écrivains mais avoue se sentir très isolé puisqu’il ne parle plus en espagnol, se sent loin de sa culture.
Au festival America, il fut aussi question de l’Amérique du Sud qui connaît guérillas, révolutions et dictatures. En temps de guerre, il est difficile de pouvoir s’exprimer librement et de publier ses textes. Horacio Castellanos Moya a payé cher sa liberté de parole. En 1977, il publie dans son pays, Le Salvador, Le Dégoût. Ce texte suscite une telle fureur de la part des Salvadoriens que la mère de l’auteur est menacée de mort. Pour échapper à la guerre civile, Horacio Castellanos Moya décide de s’exiler dans l’espoir de travailler dans de bonnes conditions et continuer d’écrire ce qu’il veut. Aujourd’hui, il vit aux Etats-Unis dans un programme d’écrivains mais avoue se sentir très isolé puisqu’il ne parle plus en espagnol, se sent loin de sa culture. 










 E
E

 V
V E
E 10
10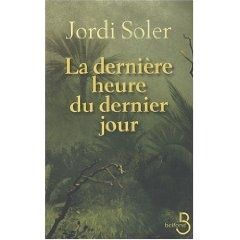
 P
P I
I