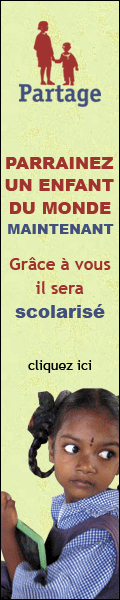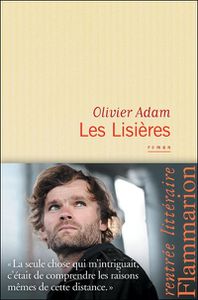 Comment échapper à la lecture des Lisières d’Olivier Adam ? Les nombreux articles pour ou contre ce roman que l’on promettait au Goncourt ont fatalement titillé ma curiosité. On sait désormais que Les Lisières n’aura pas le Goncourt puisqu’il n’apparaît pas dans la sélection du prix. Ce qui a suscité, comme un fait exprès, de nombreuses moqueries, voire des mesquineries de la part des médias. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder la photo que Le Figaro a choisie pour annoncer la nouvelle : elle représente l’auteur avant sa perte de poids. Franchement, l’attaque sur le physique n’est pas fair play. Mais, avouons-le tout de go, je n’ai pas été entièrement convaincue par ce roman nombriliste au style plat ni par cette histoire d’écrivain divorcé qui cherche à trouver sa place dans la société. Voyons donc de plus près Les Lisières.
Comment échapper à la lecture des Lisières d’Olivier Adam ? Les nombreux articles pour ou contre ce roman que l’on promettait au Goncourt ont fatalement titillé ma curiosité. On sait désormais que Les Lisières n’aura pas le Goncourt puisqu’il n’apparaît pas dans la sélection du prix. Ce qui a suscité, comme un fait exprès, de nombreuses moqueries, voire des mesquineries de la part des médias. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder la photo que Le Figaro a choisie pour annoncer la nouvelle : elle représente l’auteur avant sa perte de poids. Franchement, l’attaque sur le physique n’est pas fair play. Mais, avouons-le tout de go, je n’ai pas été entièrement convaincue par ce roman nombriliste au style plat ni par cette histoire d’écrivain divorcé qui cherche à trouver sa place dans la société. Voyons donc de plus près Les Lisières.
Dans Les Lisières, le narrateur est un écrivain nommé Paul Steiner. Séparé depuis six mois de sa femme et de ses deux enfants, il tente de comprendre pourquoi il a été ainsi plaqué : homme invivable, il a fini par lasser sa femme. Pendant de longues pages, le narrateur revient sur les moments passés auprès de Sarah. Il se larmoie, espère une réconciliation. Ennui garanti car Olivier Adam ne parvient pas à transmettre le sentiment d’abandon de façon personnelle. Surtout, il donne l’impression de tirer en longueur cette première partie.
Dans la partie centrale du roman, Paul Steiner quitte la Bretagne pour aller s’occuper de son père qui habite la banlieue parisienne, sa mère étant hospitalisée. Les relations entre le père et le fils sont minutieusement transcrites et plutôt fines. Olivier Adam évoque avec justesse un père froid et taciturne, distant avec son fils qui n’a jamais eu le droit de s’exprimer, encore moins d’émettre la moindre critique. Père et fils n’ont rien en commun, encore moins leurs opinions politiques puisque le premier vote FN au grand dam du second. Le narrateur fait également des retrouvailles dans sa banlieue morose, des anciens camarades de classe qui, pour la plupart, font des petits boulots et lui parlent de ses succès littéraires et plus encore de ses passages à la télé. J’ai été happée par cette partie puisqu’elle est souvent en empathie avec un milieu que l’auteur connaît bien puisqu'il y a grandi. J’ai entendu et lu un certain nombre de critiques sur ce point affirmant que Olivier Adam se complait dans une vision pessimiste de la banlieue alors qu'il évolue loin de ce milieu modeste. Je suis en désaccord avec ces avis : l’auteur montre justement le décalage qu’il y a entre son statut d’écrivain reconnu et ses origines. A Saint Germain, il se sent banlieusard, et en banlieue, il se sent un intellectuel supérieur. Quoi qu'il en soit, il ne trouve sa place nulle part. Ce qui peut agacer, c’est que l’auteur-narrateur ne prend pas position : il critique tout le monde, personne ne semble trouver grâce à ses yeux. Mais, c’est précisément le projet même du roman : la lisière.
Alors, pourquoi n’ai-je pas été convaincue par ce roman qui évoque si justement les relations familiales et ce sentiment d’être nulle part chez soi ? L’écriture est sans recherche, les phrases sont sans relief, sans élan… Je n’ai pas été émue par cette histoire en raison même de ce style qui m’a laissée de marbre. Dommage…
Un autre point de vue, sur le blog de la librairie Préambule, ici.











 C
C L
L I
I P
P J
J D
D Mais puisqu’il est question de liberté et de rêveries, je me suis dit, bien naïvement, que Cercle me permettrait de voyager au-delà de mon île. Allongée sur le sable, les pieds en éventail, je me suis laissé porter par la voix si particulière de Yannick Haenel. Mais dès les premières pages, notre embarcation a connu de violentes embardées. Je me suis raidie, ai senti le soleil me cramant la peau et le sable me grattant le dos :
Mais puisqu’il est question de liberté et de rêveries, je me suis dit, bien naïvement, que Cercle me permettrait de voyager au-delà de mon île. Allongée sur le sable, les pieds en éventail, je me suis laissé porter par la voix si particulière de Yannick Haenel. Mais dès les premières pages, notre embarcation a connu de violentes embardées. Je me suis raidie, ai senti le soleil me cramant la peau et le sable me grattant le dos : A
A P
P A
A