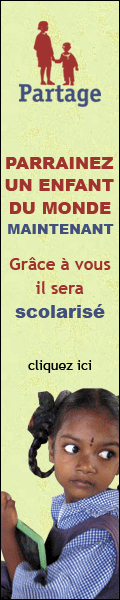Changement de décor dans Les Bienveillantes : après une période particulièrement pénible, où les Juifs furent fusillés massivement, Max Aue est envoyé en permission, à Yalta, pour se reposer quelque temps. Il se retire donc dans un sanatorium. Là, il rencontre un jeune Leutnant de la Waffen-SS, Willi Parteneau. Très vite, il se lie d’amitié avec lui et tous deux s’épanchent. On comprend pourquoi Parteneau est devenu nazi : pour échapper à un univers familial asphyxiant et ultra catholique, remplaçant la religion par le national-socialisme. De son côté, Aue raconte des souvenirs d’enfance traumatisants. Peu à peu, le désir pour Parteneau monte en lui, mais ce dernier lui rappelle que Hitler avait signé un décret condamnant à mort les homosexuels. Aue le rassure : il ne s’agit que d’une « rhétorique de façade ». Et d’ailleurs, c’est par la rhétorique qu’il compte persuader son compagnon du bienfait de l’homosexualité. Quand Parteneau séduit les jeunes Ukrainiennes ou Slaves, Aue le met en garde : celles-ci peuvent être juives et renseigner ainsi les Bolcheviques des actions ennemies, transmettre des maladies comme la syphilis, et cette activité est totalement prohibée car « une telle profanation de la race, si elle n’est pas violemment combattue, ne pourra à long terme qu’une forme d’Entdeuschung,e dégermanisation de notre race et de notre sang ». Or, cet argument est précisément celui que les nazis utilisèrent pour condamner l’homosexualité : « L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le rendement; elle détruit l'État dans ses fondements. (…) Nous devons comprendre que si ce vice continue à se répandre en Allemagne sans que nous puissions le combattre, ce sera la fin de l'Allemagne, la fin du monde germanique » (Discours du chef nazi Himmler sur l'homosexualité prononcé le 18 février 1937).
Changement de décor dans Les Bienveillantes : après une période particulièrement pénible, où les Juifs furent fusillés massivement, Max Aue est envoyé en permission, à Yalta, pour se reposer quelque temps. Il se retire donc dans un sanatorium. Là, il rencontre un jeune Leutnant de la Waffen-SS, Willi Parteneau. Très vite, il se lie d’amitié avec lui et tous deux s’épanchent. On comprend pourquoi Parteneau est devenu nazi : pour échapper à un univers familial asphyxiant et ultra catholique, remplaçant la religion par le national-socialisme. De son côté, Aue raconte des souvenirs d’enfance traumatisants. Peu à peu, le désir pour Parteneau monte en lui, mais ce dernier lui rappelle que Hitler avait signé un décret condamnant à mort les homosexuels. Aue le rassure : il ne s’agit que d’une « rhétorique de façade ». Et d’ailleurs, c’est par la rhétorique qu’il compte persuader son compagnon du bienfait de l’homosexualité. Quand Parteneau séduit les jeunes Ukrainiennes ou Slaves, Aue le met en garde : celles-ci peuvent être juives et renseigner ainsi les Bolcheviques des actions ennemies, transmettre des maladies comme la syphilis, et cette activité est totalement prohibée car « une telle profanation de la race, si elle n’est pas violemment combattue, ne pourra à long terme qu’une forme d’Entdeuschung,e dégermanisation de notre race et de notre sang ». Or, cet argument est précisément celui que les nazis utilisèrent pour condamner l’homosexualité : « L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le rendement; elle détruit l'État dans ses fondements. (…) Nous devons comprendre que si ce vice continue à se répandre en Allemagne sans que nous puissions le combattre, ce sera la fin de l'Allemagne, la fin du monde germanique » (Discours du chef nazi Himmler sur l'homosexualité prononcé le 18 février 1937).
Le jeune Parteneau est inquiet : comment assouvir sa libido s’il ne peut avoir de rapports avec les femmes du coin. La solution, selon le narrateur, se trouve dans Le Banquet de Platon. Nombreux sont les détracteurs de Littell qui lui ont reproché la culture de ce nazi. Mais, Aue l’explique lui-même : très intelligent, bon élève, il a fait des études, a lu les classiques. Faire de ce nazi un intellectuel permet de rendre plus intéressant le discours et de percevoir comment il utilise le langage pour justifier ses actes et ses choix. Grâce au Banquet, il démontre au jeune novice que les Grecs étaient des invertis qui concevaient l’activité sexuelle comme un mode de vie. Mais Parteneau est réticent : son père lui citait souvent saint Paul interdisant l’homosexualité. Aue se moque car cette « interdiction chrétienne, c’est une superstition juive » et de conclure : « j’ai d’ailleurs un ami français qui tient Platon pour le premier auteur fasciste ». Il n’en faut pas plus pour persuader Parteneau qui s’abandonne. Comme le narrateur est décidé à tout nous dévoiler, il ne se prive pas pour exprimer à quel point la pénétration est un acte agréable et fort. On avait pas vraiment envie de savoir… maintenant on sait…
En réalité, ce récit n’est pas stérile car il nous permet de comprendre le fonctionnement psychologique de Max Aue. Enfant, il tomba amoureux d’une fille de son âge : ils s’unirent mais se firent un jour surprendre. Sa mère le traité de « cochon et de dégénéré ». Tous deux furent envoyés en pension et ne se revirent plus. C’est par amour pour cette fille qu’il accepta les avances d’un garçon chargé de la protéger contre les agressions physiques des autres camarades, et finalement choisit l’homosexualité car « mieux vaut donc que moi-même je sois elle et tous les autres, moi ». Ce n’est donc pas par goût pour les hommes qu’il a choisi cette sexualité mais en souvenir de son premier amour.
Cette partie du roman des Bienveillantes est moins dans l’action mais dans la réflexion. Max Aue se pose et analyse ses actes, son langage. On ne sympathise pas avec lui, loin s’en faut, mais on entend ce parcours qui fut certainement le même pour des milliers de nazis qui ont connu une enfance rigide et sont partis en quête d’un absolu. Mais on ne pardonne pas, on n’accepte pas ses choix. On s’intéresse à son discours, on se remémore ses souvenirs sur Platon, on s’emporte contre sa sophistique. Et finalement, on poursuit avidement la lecture de ce roman ambigu et polémique.
Lire les chroniques précédentes : 1 2 3











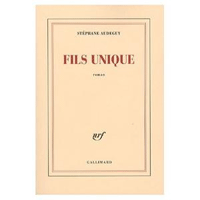 J
J